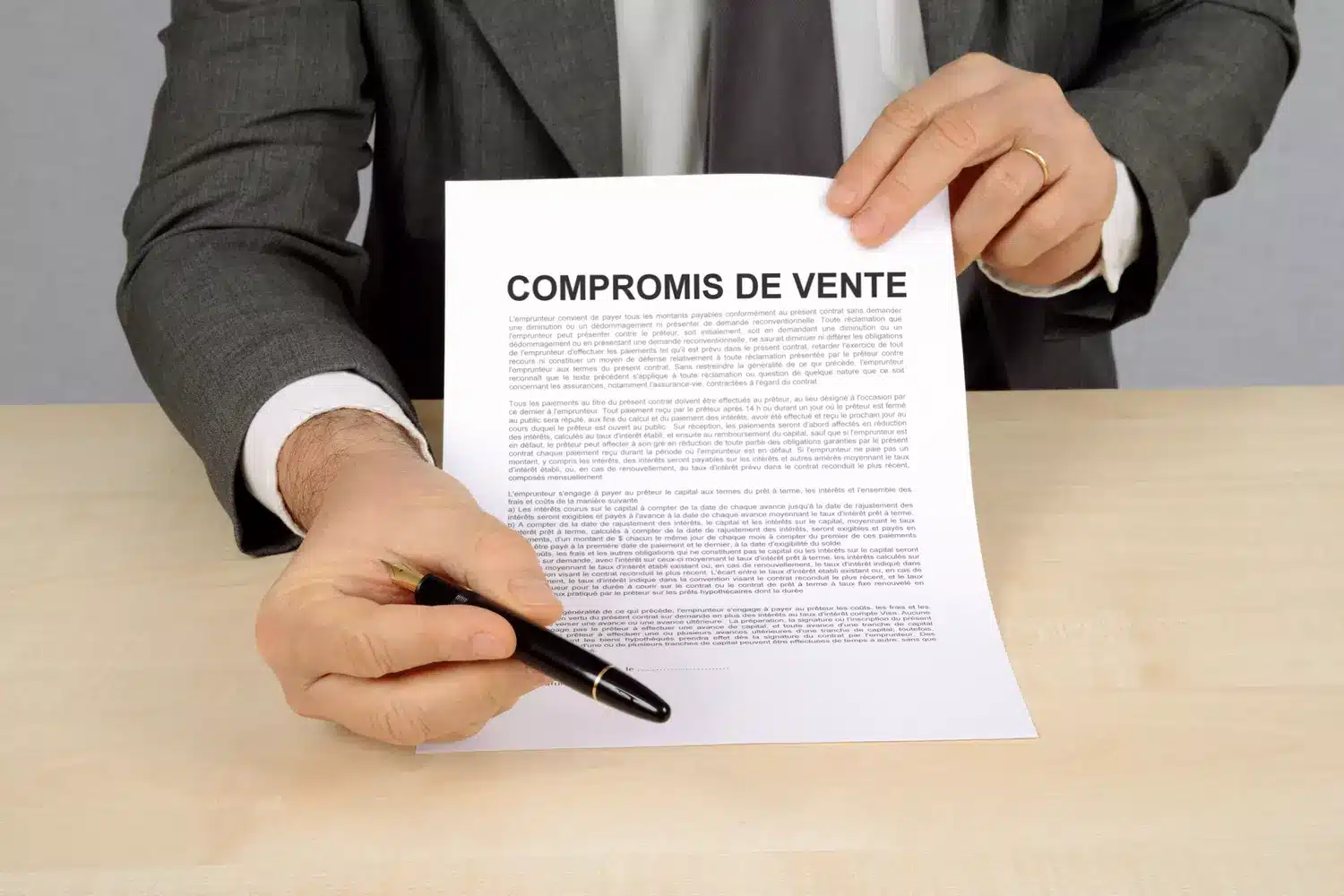L’impôt sur la fortune a disparu du paysage fiscal allemand en 1997, n’existe plus en Suède depuis 2007 et n’a jamais été instauré en Italie. La France, en revanche, a maintenu cette taxe jusqu’en 2018 avant de la transformer en impôt sur la fortune immobilière.
Alors que certains pays européens misent sur une fiscalité modérée pour attirer les capitaux, d’autres conservent des prélèvements élevés sur le patrimoine. Les écarts de taux et de base imposable créent des disparités notables dans la pression fiscale ressentie par les contribuables fortunés selon les frontières.
Panorama de la fiscalité en Europe : où se situe la France en 2025 ?
En 2025, la France continue d’afficher une pression fiscale parmi les plus élevées du continent. Les chiffres publiés par Eurostat sont sans appel : la part des prélèvements obligatoires en France tutoie les 47 % du PIB. Aucun autre pays européen ne va aussi loin. Ce niveau s’inscrit dans une histoire longue, marquée par la volonté de soutenir un système social ambitieux, des services publics puissants et une redistribution assumée.
Le contraste avec certains voisins européens saute aux yeux. Au Luxembourg, la fiscalité reste en dessous de 39 %. L’Italie et le Royaume-Uni gravitent autour de 42 %. Ces différences ne tiennent pas seulement à des choix politiques, mais aussi à la manière dont chaque pays structure ses impôts : poids de la TVA, montant des cotisations sociales, importance de la fiscalité locale. En France, la priorité est donnée au financement socialisé, ce qui pèse directement sur les salaires et la rémunération du travail, là où d’autres préfèrent taxer la consommation.
L’étude récente de l’institut Montaigne ne laisse place à aucun doute : la France conserve la première place du podium fiscal en Europe pour 2025, avec un écart net sur la moyenne de l’Union. Ce constat continue d’alimenter la controverse sur l’attractivité du pays, la compétitivité de ses entreprises et la légitimité de ses choix de redistribution.
Pour mieux situer la France, voici quelques points de repère chiffrés :
- Taux de prélèvements obligatoires en France : 47 % du PIB
- Moyenne Union européenne : 41,7 %
- Luxembourg : 38,7 %
- Italie : 42,3 %
- Royaume-Uni : 41,6 %
Mais ces chiffres ne disent pas tout. La réalité fiscale se joue aussi dans les détails : base imposable, mode de calcul, répartition entre ménages et entreprises. La France, fidèle à son modèle, reste régulièrement contestée, tout en défendant le choix d’une solidarité financée par l’impôt.
Pourquoi certains pays ont-ils supprimé ou maintenu l’impôt sur la fortune ?
L’impôt sur la fortune a suscité des décisions radicalement différentes selon les pays européens. En France, l’ISF, impôt de solidarité sur la fortune, a longtemps servi d’étendard à ceux qui voulaient taxer les plus aisés. En 2018, cette taxe a cédé la place à l’IFI, qui se concentre exclusivement sur les biens immobiliers. Le sujet reste explosif : ses partisans mettent en avant l’équilibre social, ses détracteurs dénoncent un rendement faible (à peine plus de 2 milliards d’euros récoltés en 2023) et le spectre d’une fuite des capitaux.
Dans d’autres pays, la logique diverge. La Suisse maintient une fiscalité sur l’ensemble du patrimoine, avec un impôt progressif fixé par chaque canton. En Norvège, la fortune globale est taxée dès 1,7 million de couronnes, soit environ 145 000 euros, et cette taxe rapporte plus d’un milliard d’euros par an sans déclencher de départ massif. L’Espagne, quant à elle, a renforcé temporairement son impôt sur la fortune pour faire face à la crise sanitaire, tout en laissant aux régions le soin d’en ajuster le montant.
À l’opposé, certains voisins comme la Belgique ou les Pays-Bas ont préféré tirer un trait sur cet impôt. Les raisons tiennent à la faible rentabilité de la taxe, à la complexité de l’évaluation des avoirs et à la compétition fiscale exacerbée en Europe. La fameuse « taxe Zucman », une proposition d’impôt paneuropéen sur les grandes fortunes, n’a jamais vu le jour, preuve que l’unification fiscale reste un mirage. Chaque pays trace sa voie, en fonction de sa vision de la solidarité et de la performance économique.
Comparatif des taux et modalités d’imposition sur la fortune en Europe
La façon de taxer la fortune diffère sensiblement d’un État européen à l’autre. Pour donner un aperçu concret, voici comment les principaux pays se positionnent en 2025 :
| Pays | Type d’impôt | Seuil d’application | Taux |
|---|---|---|---|
| France | IFI (immobilier) | 1,3 million € | 0,5 % à 1,5 % |
| Suisse | Patrimoine global | Variable (faible) | 0,3 % à 1 % (cantonal) |
| Norvège | Patrimoine global | ≈ 145 000 € | Jusqu’à 1,1 % |
| Espagne | Patrimoine global | 700 000 € (hors résidence principale) | 0,2 % à 3,5 % |
Ce tableau illustre combien chaque pays adapte ses seuils, ses taux et sa définition de la base imposable. En France, depuis l’IFI, seuls les patrimoines immobiliers supérieurs à 1,3 million d’euros sont concernés, avec un barème progressif qui ne touche qu’une minorité. La Suisse conserve un impôt global, prélevé localement, avec des taux souvent plus doux. En Norvège, l’imposition frappe plus bas, mais reste modérée. L’Espagne, elle, module fortement selon les régions, jusqu’à 3,5 % dans certains cas. Belgique et Pays-Bas ont tourné la page : la première sans impôt direct sur la fortune, les seconds en taxant plutôt le rendement du capital.
Derrière ces chiffres, deux visions s’affrontent : la justice fiscale contre l’efficacité économique. La concurrence fiscale européenne fait pression, les fortunes circulent, et le débat sur la redistribution reste animé dans tous les parlements.
Avantages et limites de l’impôt sur la fortune pour les États et les contribuables
L’impôt sur la fortune ne laisse personne indifférent. Pour les États, il offre un outil de redistribution et un signal politique fort, même si sa contribution au budget reste modeste. En France, l’IFI rapporte autour de 2 milliards d’euros par an : peu, comparé à l’impôt sur le revenu, mais assez pour afficher la volonté de réduire les écarts de richesse. Certains gouvernants y voient un moyen de préserver la cohésion sociale et de rappeler que la solidarité nationale n’est pas un vain mot.
Mais l’impôt sur la fortune s’accompagne de contraintes majeures. L’assiette, centrée sur l’immobilier, expose à la volatilité du marché. Le rendement reste aléatoire, et la mobilité des plus fortunés limite sa portée. Les exemples suisse et norvégien montrent que des ajustements fins des barèmes sont nécessaires pour éviter de perdre les contribuables concernés. Ailleurs, comme en Belgique ou aux Pays-Bas, on préfère miser sur la taxation du capital ou de ses revenus, pour ne pas dissuader l’investissement.
Côté contribuables, la perception oscille. Ceux qui défendent la mesure insistent sur la nécessité d’une contribution supérieure des détenteurs de patrimoine. À l’inverse, les opposants dénoncent une fiscalité perçue comme punitive, appliquée à de l’épargne déjà taxée lors de sa constitution. Le débat sur l’équilibre entre justice sociale, efficacité et attrait fiscal reste entier, dans une Europe marquée par l’hétérogénéité des dispositifs et la fluidité des capitaux. Adapter chaque système devient alors un enjeu de souveraineté, autant qu’un défi collectif pour l’avenir.